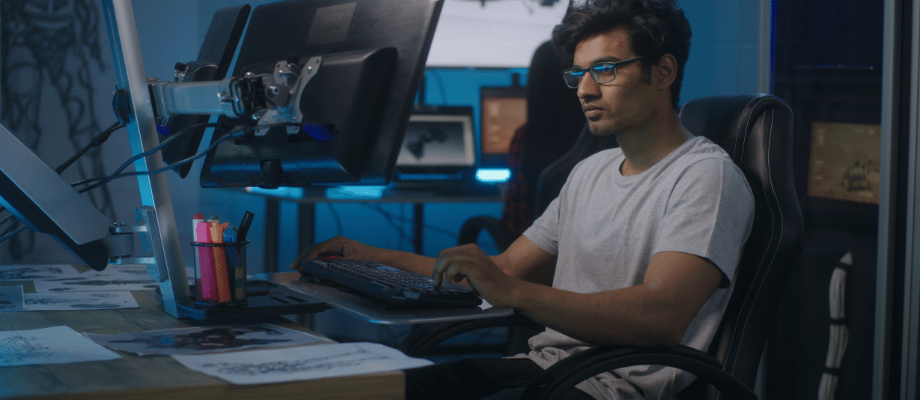Ingénieur·e Système et Réseau


I – Qu’est-ce qu’un·e Ingénieur·e Système et Réseau ?
Quel est le rôle d’un·e Ingénieur·e Système et Réseau ?
L’Ingénieur·e système et réseau conçoit, met en place, exploite et fait évoluer les infrastructures informatiques qui portent les systèmes d’information au quotidien : serveurs, réseaux LAN/WAN/SD-WAN, Wi-Fi, cloud public/privé, stockage, sauvegarde, annuaires, accès distants, solutions de sécurité informatique. Sa mission première : assurer la disponibilité, la performance et la sécurité des informations, tout en garantissant un fonctionnement fluide pour les utilisateurs et les métiers.
Concrètement, cette fonction d’ingénieur s’inscrit à l’intersection du technique et de l’organisation. Elle consiste à analyser les besoins, concevoir l’architecture systèmes et réseaux la plus adaptée, gérer l’intégration des équipements informatiques et des logiciels d’administration, puis assurer la maintenance et le MCO/MCS (exploitation et supervision). L’ingénieur·e agit en professionnel de la sécurité, en prévention comme en réponse aux incidents.
Quelles sont les missions d’un·e ingénieur·e système et réseau ?
La première grande mission consiste à concevoir puis mettre en place des architectures fiables, adaptées au besoin de l’entreprise et à son environnement. Concrètement, on parle de virtualisation sur hyperviseurs, de conteneurs orchestrés, d’interconnexions réseau bien pensées (routage, switching, VLAN, QoS, VPN, DNS/DHCP, proxy), et d’un socle cloud (IaaS/PaaS) qui tient la charge. Cette phase de design va de pair avec la sécurité dès la conception : pare-feu, WAF, IAM/MFA, chiffrement des flux et des données, segmentation, et préparation de la haute disponibilité ainsi que du PRA/PCA. L’objectif est simple : livrer une infrastructure claire, documentée, qui répond aux usages des utilisateurs et qui peut évoluer sans problèmes.
Ensuite, il y a le quotidien de l’exploitation et de la maintenance. L’ingénieur·e suit l’état du système (disponibilité, charge, alertes), ajuste les ressources pour éviter la saturation, applique régulièrement les mises à jour et contrôle les sauvegardes, y compris celles protégées contre toute modification. Il/elle renforce la configuration des serveurs, prépare, teste et annonce chaque changement avant son déploiement pour éviter les effets de bord sur le système d’information. La priorité reste stabilité et performance. Chaque action est consignée (quoi, qui, quand, pourquoi) afin que l’équipe puisse reprendre le dossier à tout moment.
La gestion de projet fait également partie intégrante du métier. Il faut cadrer le périmètre, établir un planning réaliste, chiffrer les options, choisir les outils et les logiciels d’administration, puis se charger du suivi jusqu’à la mise en production. La mesure de la qualité de service (SLA/SLO), la documentation, les transferts de compétences et le reporting régulier au responsable de service ou au manager assurent une gouvernance lisible. Ce travail de gestion permet d’aligner l’organisation technique sur les priorités des métiers, tout en gardant le contrôle des coûts et des risques.
Quand un incident survient, l’ingénieur·e prend la main sur le support avancé. Il ou elle analyse les "symptômes", recherche la cause racine, propose une solution et met en œuvre un plan d’actions à la fois correctif et préventif. L’objectif n’est pas seulement de rétablir le service : c’est d’éviter la récidive en mettant en place des garde-fous, le tout, en améliorant les procédures d’exploitation. Cette capacité à intervenir vite, calmement, et à capitaliser sur l’expérience fait la différence dans la durée.
La sécurité des informations traverse toutes ces activités. Au-delà des briques techniques, il s’agit de définir des politiques d’accès claires, de segmenter les environnements, d’assurer la conformité du secteur d’activité, de reporter les événements et de vérifier régulièrement les tests de restauration. La gestion des vulnérabilités et la tenue à jour des composants s’intègrent à la routine, avec un suivi précis des mesures engagées. Ici encore, la valeur est dans la cohérence : des règles simples, appliquées partout, et des contrôles qui prouvent l’efficacité du dispositif.
Enfin, la veille technologique est aussi une mission pour ce professionnel de l'informatique. Les technologies sont très changeante, il est donc indispensable de suivre les évolutions technologiques, tester les nouveaux outils qui peuvent apporter un vrai plus, puis proposer des améliorations quand elles sont utiles et maîtrisées. L’enjeu n’est pas d’ajouter de la complexité, mais de faire évoluer l’architecture avec pragmatisme, au rythme de l’organisation et du marché, pour maintenir la qualité de service, la sécurité et la performance.
Quels sont ses principaux interlocuteurs ?
- Les utilisateurs et métiers (finance, production, opérations, ect.) pour répondre aux besoins et garantir la qualité de service.
- Les équipes de développement (Dev, Data, Product) pour lier les contraintes applicatives à l’infrastructure.
- L’architecte SI, l’administrateur système / administratrice réseau, le/la manager d’exploitation, le/la responsable sécurité.
- Les partenaires de télécommunication (opérateurs, intégrateurs), les éditeurs et constructeurs matériel/logiciel.

II – Quelles sont les compétences et les qualités requises pour exercer ce métier ?
Parce qu’il mêle système, réseau et service aux utilisateurs, ce métier demande autant de technique que de soft skills.
Les compétences techniques
- Administration systèmes (Linux & Windows Server) : l’ingénieur·e maîtrise les services d’infrastructure, les annuaires (AD/LDAP), les politiques GPO et la PKI afin d'assurer un environnement stable et sécurisé.
- Virtualisation et conteneurs : il/elle exploite VMware/Hyper-V/KVM et utilise Docker/Kubernetes pour standardiser les déploiements et simplifier les montées de version.
- Stockage, sauvegardes et PRA/PCA : la stratégie de sauvegarde est définie, testée et documentée, avec snapshots, réplications et sauvegardes protégées pour garantir la reprise d’activité.
- Automatisation et IaC : des scripts (Bash, PowerShell, Python), Ansible et Terraform sont utilisés pour décrire l’infrastructure, réduire les tâches manuelles et fiabiliser les changements.
- Réseau d’entreprise : l’ingénieur·e maîtrise TCP/IP, VLAN, routage (OSPF/BGP), NAT, QoS et VPN pour garantir une connectivité fiable entre les sites, les datacenters et le cloud.
- Services réseau : DNS, DHCP, NTP, proxy et équilibrage de charge sont configurés avec soin et intégrés à la supervision pour éviter les points de fragilité.
- Sécurité réseau : les pare-feu nouvelle génération, IDS/IPS, NAC et la micro-segmentation sont mis en place pour limiter les risques et contenir les mouvements latéraux.
- Wi-Fi, WAN et SD-WAN : le Wi-Fi d’entreprise, les interconnexions multi-sites et le SD-WAN sont pilotés pour garantir la disponibilité et la performance des applications.
- Cloud public (AWS/Azure/GCP) : l’architecture s’appuie sur des VPC/VNet segmentés, une IAM rigoureuse, des liaisons hybrides sécurisées et un suivi des coûts et de la conformité.
- Observabilité et supervision : logs, métriques et traces sont collectés et corrélés (SIEM/XDR) avec des alertes pertinentes et des objectifs de service (SLA/SLO) suivis dans le temps.
- Sécurité du SI : la gouvernance des accès (RBAC, MFA), le durcissement des hôtes, le chiffrement des données et la gestion des vulnérabilités sont intégrés dès la conception.
Les soft skills
- Communication : l’ingénieur·e doit être en mesure d'expliquer les choix techniques, préparer les utilisateurs aux changements et tenir informées les parties prenantes (en adoptant un langage compréhensible pour un public non avertis) .
- Organisation et rigueur : la planification, la gestion des priorités et la tenue d’une documentation utile est indispensable.
- Esprit d’analyse : la lecture des indicateurs aide à diagnostiquer rapidement un incident et à choisir la solution la plus adaptée.
- Sens du service : l’écoute des besoins et la recherche d’un fonctionnement simple et fiable guident les décisions techniques.
- Travail en équipe : la coopération avec l’architecte, les administrateurs, les équipes Dev/Sec/Ops/Data et les partenaires télécom fluidifie les projets.
- Curiosité et veille : la technologie évolue vite ; tester ce qui a du sens et proposer des améliorations mesurées évite la sur-complexité et renforce la qualité de service.
III – Comment devenir un·e ingénieur·e système et réseau ?
Parcours académiques recommandés
Pour accéder au métier d'ingénieur.e système et réseau, un diplôme de niveau Bac+5 est généralement requis. La voie la plus prisée est l'obtention d'un diplôme d'ingénieur, que ce soit via une école spécialisée en informatique et télécommunications ou une école généraliste avec une option dédiée. Ces écoles sont accessibles après une classe préparatoire scientifique (CPGE), après le bac (prépa intégrée) ou en admission parallèle.
L'autre parcours le plus courant est le cursus universitaire, via un Master en informatique offrant des spécialisations telles que "Réseaux et Télécommunications", "Sécurité des Systèmes d'Information (SSI)" ou "Cloud Computing".
Bien que le Bac+5 soit la cible, il est courant de débuter par un diplôme de niveau Bac+2 (comme le BTS SIO option SISR ou le BTS SN) ou Bac+3 (BUT Réseaux et Télécommunications ou BUT Informatique). Ces formations techniques permettent une insertion en tant que technicien.ne supérieur.e ou administrateur.trice, et servent de tremplin pour poursuivre vers le niveau ingénieur, souvent par la voie de l'alternance.

IV – Quelles perspectives d’évolutions ? Quelle rémunération ?
Perspectives d’évolution
Le poste d'ingénieur.e systèmes et réseaux est rarement une finalité ; il constitue un excellent tremplin vers des postes à plus haute responsabilité. Après plusieurs années d'expérience, l'évolution peut se faire dans deux directions principales. D'une part, vers l'expertise technique, en devenant Architecte infrastructure, Expert.e en Cybersécurité ou Consultant.e spécialisé.e (notamment en Cloud/DevOps) afin de concevoir et auditer des systèmes complexes. D'autre part, vers le management, en accédant à des postes de Chef.fe de projet infrastructure pour piloter des déploiements majeurs, puis de Responsable infrastructure pour gérer une équipe. À terme, ces parcours peuvent mener à des fonctions de direction stratégique comme Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) ou Directeur.trice des Systèmes d'Information (DSI).
Rémunération
De nombreux facteurs entrent en jeu (missions, secteur, périmètre, taille de l’entreprise, localisation, compétences atypiques, etc.). Pour donner une idée des rémunérations, voici des fourchettes issues de l’Apec selon les paramètres suivants : Ingénieur systèmes réseaux F/H, Bac+5 (école d’ingénieurs), cabinet de conseil de 599 à 999 salariés, Île-de-France.
- Junior (< 4 ans d’expérience) : 38,5 à 49,3 k€ brut/an
- Confirmé (6–8 ans) : 41,3 à 52,9 k€ brut/an
- Senior (9–16 ans) : 46,6 à 60,2 k€ brut/an
Pour une estimation plus précise, adaptée à votre profil et à nos projets, nous vous invitons à consulter nos offres d’emploi.
Conclusion
Si vous êtes curieux, rigoureux, et que vous aimez comprendre comment "tout fonctionne" (du serveur au réseau, en passant par le cloud), le métier d'ingénieur·e systèmes et réseaux est un excellent choix. En choisissant cette voie, vous optez pour un métier concret et stimulant, et qui vous garantit de ne jamais cesser d'apprendre, avec de réelles perspectives d'évolution.
Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi ?
Découvrez nos dernières offres d’emploi sur notre site talents et rejoignez le Groupe IT Link pour travailler sur des projets concrets, répondre aux besoins d’acteurs exigeants.
Pour approfondir vos connaissances sur ce métier passionnant, plongez-vous dans les articles de notre blog (retours d’expérience, bonnes pratiques, cas d’usage). Ensemble, propulsons votre carrière vers de nouveaux sommets !
Candidature spontannée
Aucune offre ne correspond à votre profil actuellement ? Partagez-nous votre candidature spontanée !